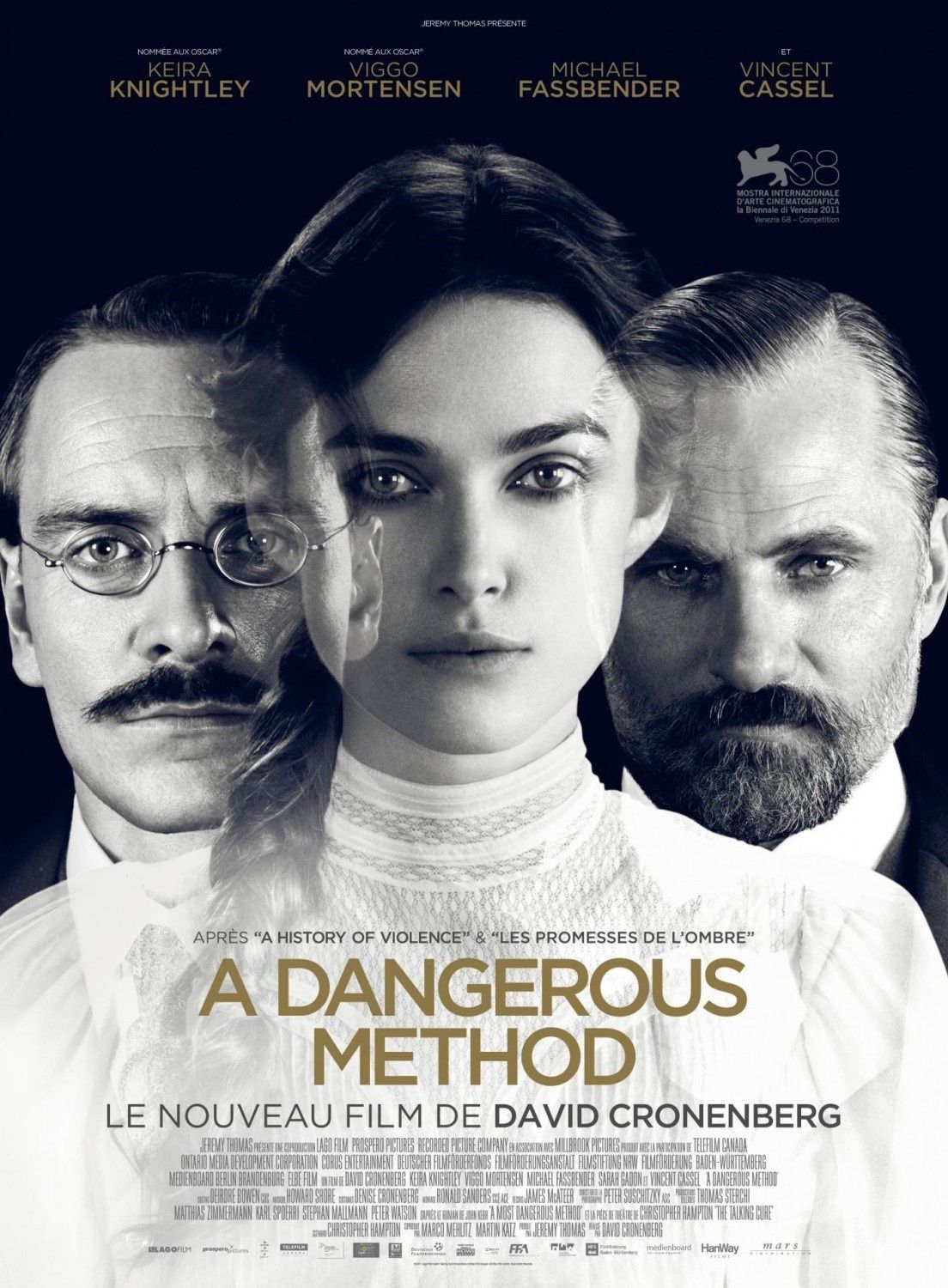Après l'épouvantable numéro 1 de cette désormais moins brève série "Qu'est-ce qu'un blog ciné ?", je voulais revenir un peu, latéralement, sur cette activité du blog ciné - et qui peut se flatter d'être davantage latéral que votre serviteur, lequel n'a pas proféré la moindre chose en ce lieu sans lieu depuis plus d'un an ? De même, qui peut mieux juger de l'activité sinon un furieux engagé dans l'inactivité ?
Un fait d'abord, misérable de confession et de partialité : je n'aime pas le cinéma. Ou du moins j'aime moins le cinéma que l'écriture et les idées que le cinéma métamorphose en cinéma. Or ce point précisément conteste l'expérience majoritaire du blog ciné ; que ce moi qui aime les idées-cinéma est autre que ce moi qui aime le cinéma - avec ses idoles, ses opinions, ses préjugés rhétoriques et marchands.
Une remarque adjacente, (remarque sur toute confession, à rendre intolérable toute phrase porteuse d'un "j'aime" ou "je n'aime pas" comme ci-dessus) : il est probable que le blog, plutôt que de lier des libertés, constitue en réalité des servilités ; un espace comme tant d'autres et peut-être mieux que certains autres où je suis insidieusement amené à avouer des plaisirs et des désirs traçables, identifiables, commercialisables. Dire sa sensibilité et la manière dont son corps réagit machinalement à tel appât filmique n'a non seulement aucun intérêt, mais s'avère même pernicieux (imagine qu'un démon vienne te visiter une nuit et, prêt à enregistrer tes envies comme des données, t'exhorte de la sorte : "avoue ton plaisir, ton désir, ton opinion et ton goût. Donne moi ton avis sur tout...").
Un désir ensuite : j'aimerais simplement mettre en discours ce qui n'a fait que se dévoiler de lui-même, à mesure de l'écriture : que le blog ciné ne doit pas être ce qu'il est. Ce qu'il est, un ensemble de goûts affichés, de préférences irréfléchies, de plaisirs et de désirs affichés par un spectateur lâche et paresseux. Ce qu'il doit être, un jugement sur les idées que le film se propose de traiter, que ces idées soient purement philosophiques (au sens où toute idée est philosophique) ou bien cinématographiques-esthétiques (au sens peut-être où Deleuze parlait d'idées-cinéma...) : travail sur les couleurs de l'image, les jeux sur l'espace et le temps, les types de mouvement imposés à l'image, en somme ce que l'on a pour habitude de regrouper, et peut-être hâtivement pour cette raison qu'il s'agit bien d'idées, sous la catégorie de "forme".
Une conséquence : importe moins la subjectivité des goûts et des couleurs que l'objectivité des idées développées, leur cohérence, leur intérêt, leur innovation au sein d'une histoire, leur tour de force à l'intérieur d'un champ d'autres forces. On m'objectera sûrement que le blog n'est fait que pour cela, partager ses goûts et ses couleurs, et qu'il n'y a qu'à retourner à mes dissertations, si tel est mon plaisir ; mais qu'ici toutefois nous échangeons bien pour dire si et combien nous avons été émus, renversés, ou indifférents. Et peut-être, d'ailleurs, fus-je et serai-je amené à dire, comme par un fiévreux rappel du plaisir à parler de ses plaisirs, que "j'ai bien aimé". Il me faudra cependant évincer asymptotiquement, puisque tel est "le nouvel idéal", tous ces écueils sensibles, afin de n'être vigilant qu'aux idées (quelque chose comme le "thème", la "thèse", les "arguments" et les "exemples" cinématographiques). Un film n'est pas un bloc sensoriel devant lequel j'aurais à cliquer sur "j'aime", mais une oeuvre qui soutient une position intellectuelle et esthétique, dans un devenir et contre d'autres positions. Apprécier un film, ce n'est pas engager son moi passionnel dans un rapport d'attirance/répulsion avec lui, c'est exalter son moi intelligent dans un rapport de dialogue critique : pensée contre pensée.
Une objection : ce désir de vérité n'entraîne-t-il pas la négation même ("l'auto-contradiction") du discours sur l'art, centré sur le beau, c'est-à-dire la manière en apparence subjective dont je, tu, il trouve telle oeuvre belle et telle autre laide ? A cela peut-être répondrai-je avec l'accent du vieux maître de Königsberg, et clamerai-je sans doute qu'en matière d'art une objectivité forte doit se fonder au coeur d'une subjectivité forte, et que ce qui est beau, c'est moins l'objet comme tel que le libre jeu des facultés intellectuelle et imaginative à l'intérieur du sujet. Le beau peut bien relever d'une prétention universaliste, s'ancrer au coeur du sujet, et ne pas remettre en cause un discours qui, désormais, voudrait ne s'en tenir qu'aux idées. Le désir de vérité peut en même temps vouloir haïr le bon, et aimer le beau.
Un impératif enfin : "n'avoue ni ton plaisir, ni ton désir, ni ton opinion, ni ton goût". Ou, de manière plus concise et peut-être plus joueuse : "donne un avis qui refuse catégoriquement de donner un avis".
Les autres numéros de "Qu'est-ce qu'un blog ciné ?" :